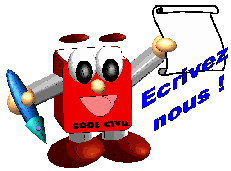La commission européenne est l’une des institutions communautaires au sens de l’article 4 du traité de Maastricht mais est surtout l’institution la plus originale de la communauté pour 2 raisons :
- par son statut et sa composition caractérisés par l’indépendance.
- par sa fonction : institution chargée de promouvoir l’intérêt de la communauté (ce qui en fait aussi l’institution la plus critiquée avec la CJCE)
Elle doit cependant aujourd’hui faire face à de nouveaux défis.
I/ Une institution originale de par son statut et sa fonction.
Un organe collégial et indépendant.
Composition :
Selon l’article 157 du traité CE, la commission est composée de 20 commissaires indépendants, nommés pour 5 ans renouvelables : seuls 5 Etats disposent de 2 sièges : la France, l’Allemagne, le RU, l’Italie et l’Espagne.
L’indépendance des commissaires provient davantage de leur statut que de la procédure de désignation : Une fois nommés, les commissaires ne peuvent accepter aucune instruction ni d’un Etat ni d’un organisme privé, ils ne peuvent exercer une autre activité professionnelle pendant l’exercice de leurs fonctions. Ils prêtent serment devant la CJCE. Ces obligations sont sanctionnées : la CJCE peut être saisie soit par le conseil soit par la commission elle-même. Elle peut prononcer la démission d’office de l’intéressé, la déchéance de son droit à pension. Mais en contrepartie, les commissaires ont un statut de protection qui joue vis à vis des Etats membres et vis à vis du conseil : la non révocabilité des membres de la commission.
Procédure de désignation
: elle a évolué avec l’approfondissement de la construction communautaire et le renforcement des pouvoirs du PE. Avant le TM les commissaires étaient nommés d’un commun accord par les gouvernements des Etats membres. L’article 158 al 2 du Traité de Maastricht ajoute la consultation du parlement sur le choix du président puis sur l’ensemble de la commission. Depuis le traité d’Amsterdam, le président de la commission doit être investi par un vote puis il donne les noms des commissaires et le PE, après les avoir entendus, procède à un vote d’ensemble sur la commission.La commission s’appuie sur 24 directions générales organisées par domaines, un secrétariat général et un service juridique ainsi qu’une dizaine de services spécialisés soit environ 15000 fonctionnaires.
Le rôle de la commission : la promotion et la garantie de l’intérêt communautaire
Elle assure son rôle de garante de l’intérêt communautaire grâce aux pouvoirs que lui confère l’article 155 du Traité de Maastricht.
 Pouvoir de gardienne des traités : une spécificité de la construction communautaire et du pilier communautaire.
Pouvoir de gardienne des traités : une spécificité de la construction communautaire et du pilier communautaire.
La commission est chargée de protéger les traités vis à vis des Etats grâce à un accès privilégié à la CJCE notamment dans la procédure de recours en manquement (faire constater par la CJCE qu’un Etat a manqué à ses obligations découlant du traité ou des actes dérivés) puisqu’elle n’a pas à prouver un intérêt à agir. Des procédures lui permettent également de contrôler l’application des traités par les Etats (ex : contrôle sur les aides aux entreprises) et de la clause de sauvegarde ( quand un Etat demande la suspension de l’application de certaines mesures du traité du fait de risques importants pour son économie).
Cet accès privilégié à la CJCE lui permet également de faire sanctionner le non respect par les autres institutions des procédures inscrites dans le traité (mais c’est un pouvoir peu utilisé).
Vis à vis des personnes privées et surtout des entreprises, la commission dispose de pouvoirs importants : pouvoir général d’information (demander à une entreprise des informations sur sa comptabilité…), pouvoir de contrôle (respect des règles communautaires par entreprise) pouvoir de sanction (surtout pécuniaires notamment quand entreprise ne respecte pas les règles de concurrence communautaires (ententes, abus de position dominante…)).
 Pouvoir d’initiative ou de proposition :
Pouvoir d’initiative ou de proposition :
En matière de révision des traités : elle déclenche la procédure de révision de l’article N.
Pouvoir de proposition en matière budgétaire et dans le cadre du processus de décision communautaire (initiative des actes communautaires). Ce pouvoir joue de 2 manières :
- commission a le quasi-monopole de l’initiative et le plus souvent (90% des cas), le conseil ne peut décider que sur proposition de la commission.
- Ce pouvoir a un effet juridique qui s’étend sur les modalités de vote au sein du conseil : si le conseil reprend la proposition de la commission, il se prononcera à la majorité qualifiée. Mais s’il veut l’amender, il ne peut le faire qu’à l’unanimité.
Le pouvoir d’initiative de la commission a évolué avec le TM : PE peut demander à la commission de mettre en œuvre ce pouvoir.
 Pouvoir propre de décision : moins étendu que dans le cadre de la CECA. Un pouvoir autonome de décision dans domaine de l'union douanière. Un pouvoir de décision subordonné s’exerçant pour exécuter les actes adoptés par le conseil.
Pouvoir propre de décision : moins étendu que dans le cadre de la CECA. Un pouvoir autonome de décision dans domaine de l'union douanière. Un pouvoir de décision subordonné s’exerçant pour exécuter les actes adoptés par le conseil.
 Pouvoir d’exécution de la commission des actes du conseil. Article 145 TCE. Le conseil est tenu de déléguer à la commission le pouvoir d’exécution à
la commission est l’exécutif de droit commun en droit communautaire.
Pouvoir d’exécution de la commission des actes du conseil. Article 145 TCE. Le conseil est tenu de déléguer à la commission le pouvoir d’exécution à
la commission est l’exécutif de droit commun en droit communautaire.
+ pouvoir qu’elle détient dans domaine des accords externes (art 228 TCE) : sous contrôle du conseil, commission propose d’ouvrir les négociations avec les Etats ou les organisations internationales et elle conduit les négociations.. La compétence pour conclure l’accord appartient au conseil.
+ pouvoir d’administration de la commission : c’est aux Etats qu’il revient d’appliquer prioritairement le droit communautaire mais elle a un pouvoir d’administration par exemple sur les fonds communautaires (FEDER…).
 Pouvoir général de recommandation et d’avis de la commission
Pouvoir général de recommandation et d’avis de la commission
ex : dans le cadre de la concurrence, aides publiques…
II/ Défis et enjeux aujourd’hui pour la commission européenne.
 Sa composition est-elle purement communautaire ? On peut en douter car l’attribution de sièges par Etat prend en compte l’importance de l’Etat. La règle qui attribue deux sièges à 5 Etats a peu de justification dans une institution qui n’est en principe pas intergouvernementale. La question de l’avenir de cette règle et du nombre maximum de commissaires est posée avec la perspective de l’élargissement.
Sa composition est-elle purement communautaire ? On peut en douter car l’attribution de sièges par Etat prend en compte l’importance de l’Etat. La règle qui attribue deux sièges à 5 Etats a peu de justification dans une institution qui n’est en principe pas intergouvernementale. La question de l’avenir de cette règle et du nombre maximum de commissaires est posée avec la perspective de l’élargissement.
 La commission doit faire face aux tâches nouvelles qui lui sont confiées et qui se multiplient (programmes PHARE, TACIS, MEDA… ) : la commission européenne dispose de peu de personnel pour les gérer et a dû faire appel à des mandataires et sociétés privées. Cela nécessite un contrôle fort qui n’a pas été mis en place ce qui est en grande partie à l’origine de la crise actuelle de la commission et de la mise en cause de certains commissaires.
La commission doit faire face aux tâches nouvelles qui lui sont confiées et qui se multiplient (programmes PHARE, TACIS, MEDA… ) : la commission européenne dispose de peu de personnel pour les gérer et a dû faire appel à des mandataires et sociétés privées. Cela nécessite un contrôle fort qui n’a pas été mis en place ce qui est en grande partie à l’origine de la crise actuelle de la commission et de la mise en cause de certains commissaires.
 L’évolution des relations entre la commission et le PE face à la volonté du parlement de renforcer ses pouvoirs.
L’évolution des relations entre la commission et le PE face à la volonté du parlement de renforcer ses pouvoirs.
Les auditions des futurs commissaires seront certainement encore plus approfondies. Le PE voudrait un vote individuel, sur chaque commissaire. Cela pose deux problèmes : concurrence entre légitimités des commissaires et problème de fond : la commission est une instance collégiale et doit être investie comme telle. Le débat sur la procédure de désignation pose la question de l’évolution des communautés vers un modèle interne de type parlementaire face à la très grande indépendance de la commission à l’heure actuelle.
L’évolution de la mise en cause de la responsabilité de la commission : le PE peut voter une motion de censure en vertu de l’article 144 (existe depuis l’origine) : mécanisme inspiré du modèle parlementaire interne et vise à faire de la commission un organe exécutif politiquement responsable. Cette procédure n’a cependant jamais fonctionné, en partie car la commission de dépendait pas, jusqu’au TM, du PE pour sa nomination. Depuis le TM, la question de la dépendance de la commission vis à vis du PE réapparaît : la commission est encadrée au stade de sa désignation et de sa censure. Une censure ne semble plus impossible depuis la crise de la vache folle : le 19 février 1997, le PE a adopté une résolution contre la commission : " résolution de sanction avec sursis " (une première juridique) : PE a laissé 9 mois au président de la commission (J.Santer) pour réformer ses services (car crise de la vache folle est imputée au mauvais fonctionnement des services de la commission) sinon elle pourrait être contrainte à démissionner par le PE. Ce n’est qu’une demi-mesure car conditionnelle mais c’est un progrès concernant la responsabilité politique de la commission.
La démission de la commission en mars 1999 peut ainsi être liée à la montée en puissance du PE et à la lutte de pouvoir entre ces deux institutions qui révèlent les dysfonctionnements de la commission.
Les institutions de la communauté ont une finalité commune décrite à l’article 4 du traité CE : réaliser la finalité économique de la communauté mais également œuvrer dans le sens de l’intégration juridique et politique. Chaque institution a ainsi des pouvoirs différents et il doit y avoir collaboration entre elles. La commission par son caractère original a un rôle moteur dans ce processus mais elle doit aujourd’hui être capable de repartir sur des bases saines.

Etudiante à Science Po Paris, et licencié en droit. Vous pouvez comme elle nous transmettre par mail des documents rédigés par vos soins et nous les mettrons en ligne s'ils correspondent à nos critères :) |
|---|