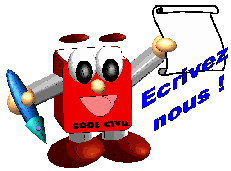La dissertation nous a été envoyée par Farouk Bouanani, qui a recu la note de 15/20 à ce devoir rédigé chez lui, dans le cadre du centre audiovisuel d'études juridiques.
Introduction
" En 1998, plus de 80 % des textes nationaux seront d’origine communautaire ", déclarait Monsieur Jacques DELORS, président de la commission de Bruxelles après la signature du traité de Maastricht.
Si la proportion invoquée lors de cette déclaration est quelque peu démentie par l’histoire, sa signification, lourde de sens, reste d’actualité.
La construction européenne a en effet conduit les Etats signataires des différents traités à construire un ordre juridique nouveau, le droit communautaire, ou droit de l’Union européenne.
Celui-ci, bien que né dans l’ordre international, a, bien plus que ce dernier vocation à régler des problèmes qui concernent directement, les Etats signataires, mais aussi leurs ressortissants.
Se pose alors la question relative à la souveraineté de chacun des Etats membres.
Au-delà des clivages politiques traditionnels, cette question divise.
N’en témoigne la place du droit communautaire par rapport à la constitution, qui, aujourd’hui encore, partage la doctrine.
Pourtant, une fois les traités ratifiés, les règles communautaires sont de plus en plus présentes. Il convient alors d’analyser quelle est la portée du droit communautaire en droit interne a travers sa primauté (I) et son invocabilité (II).
 I- La primauté du droit communautaire sur le droit national.
I- La primauté du droit communautaire sur le droit national.
En droit international, les traités s’imposent aux Etats, au risque de mettre en jeu leur responsabilité internationale. Cependant, ces derniers ne concernent que les Etats, sans qu’une incidence directe leur soit imposée en droit interne.
Pour le droit communautaire, la cour de justice, par l’arrêt Costa c/ ENEL (15 juillet 1964), a affirmé le principe de la primauté du droit communautaire (A), et ainsi imposer sa mise en oeuvre par les autorités nationales (B).
 A- Le principe de la primauté du droit communautaire.
A- Le principe de la primauté du droit communautaire.
Bien que le traité de Rome ne pose pas un principe général de primauté, par l’arrêt Costa, la Cour de justice invoque non seulement les termes du traité, mais aussi son esprit.
Déjà, un an auparavant, dans l’arrêt Van Gend en Loos, elle avait affirmé le principe d’intégration du droit communautaire dans le droit national.
C’est donc à partir de l’interprétation de la cour que s’affirme le principe de primauté du droit communautaire.
Dans l’arrêt Van Gend en Loos, elle avait tempéré sa position en déclarant : " les Etats ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains ". Les termes de l’arrêt Costa affirment ce principe avec encore plus de netteté : " le traité a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des Etats membres et qui s’impose à leurs juridictions ".
Par l’affirmation de ce principe, c’est la garantie d’une application uniforme du droit communautaire qui est recherché.
En effet, si l’application du droit communautaire pouvait se voir opposé une règle juridique interne contraire, son efficacité serait réduite à néant.
Cependant, sa mise en oeuvre ne s’est pas fait sans la réticence de certains Etats, et des aménagements ont parfois été nécessaires.
 B- La mise en oeuvre du principe de primauté du droit communautaire en droit interne.
B- La mise en oeuvre du principe de primauté du droit communautaire en droit interne.
La conséquence directe de la primauté du droit communautaire est de rendre inapplicable le droit national contraire.
Si la question est simple, s’agissant de lois antérieures, qui, de facto, sont considérées comme étant abrogées, le problème s’est posé pour l’application d’une loi nationale postérieure.
La cour de justice, par la voie du renvoi préjudiciel, s’est clairement positionnée, ainsi, dans l’arrêt Simmenthal (9 mars 1978), elle déclare : " le juge national a l’obligation d’assurer le plein effet des normes communautaires, en laissant au besoin inappliqué, de sa propre autorité, toute disposition contraire nationale, même postérieure, sans qu’il y ait à demander ou attendre l’élimination de celle-ci par voie législative ou tout autre procédé constitutionnel ".
En France, les juges nationaux, par une interprétation conciliatrice, ont cependant tempéré cette jurisprudence, les règles procédurales relevant de la compétence nationale.
Mais par l’arrêt Société des Cafés J.Vabre (24 mai 1975), la cour de cassation, s’appuyant non seulement sur le principe de primauté du droit communautaire, mais aussi sur l’article 55 de la constitution, a entraîné les juridictions judiciaires à appliquer pleinement le principe de primauté du droit communautaire.
Le conseil d’Etat, lui, s’est longtemps refusé à faire prévaloir les traités sur les lois postérieurs contraires (C.E. 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France ).
En 1989, il s’est finalement résigné à appliquer le principe de primauté du droit communautaire en s’appuyant sur l’article 55 de la constitution (C.E. 20 octobre 1989, Nicolo).
 II- L’invocabilité des règles communautaires en droit interne.
II- L’invocabilité des règles communautaires en droit interne.
Ces effets se traduisent de différentes manières selon qu ‘il s’agisse de traités communautaires (A), de règlements et de décisions adressées aux particuliers (B), de directives et de décisions adressées aux Etats (C).
 A- Les traités communautaires
A- Les traités communautaires
Les dispositions des traités communautaires créent des obligations à l’égard des Etats, ainsi, en a décidé la jurisprudence initiée par l’arrêt Van Gand en Loos.
Mais pour être directement invocable, il faut des dispositions qui imposent aux Etats une obligation inconditionnelle de s’abstenir, ou une obligation de faire devenues inconditionnelle, après une période transitoire déterminée.
Ainsi, il est mis échec aux carences des institutions, dans la mise en application de mesures annoncées par le traité.
Le principe est de permettre aux particuliers d’invoquer ces dispositions à l’égard de l’autorité publique.
Néanmoins, il arrive que certaines dispositions du traité créent des obligations à la charge des particuliers ou des entreprises, telle, dans le cadre de relations contractuelles (effet direct horizontal), l’article 6 CE, non discrimination à raison de la nationalité.
 B- Règlements et décisions adressées aux particuliers.
B- Règlements et décisions adressées aux particuliers.
Les règlements sont applicables sans procédures de réception. Ils sont alors invocables devant les juridictions nationales, non seulement à l’encontre de l’autorité publique (effet vertical), mais aussi entre justiciables (effet horizontal).
Les décisions adressées aux personnes physiques ou morales sont invocables devant les juridictions nationales, au même titre que les règlements.
 C- Les directives et les décisions adressées aux Etats.
C- Les directives et les décisions adressées aux Etats.
Les directives ou décisions adressées aux Etats ne sont destinés à atteindre les particuliers qu’après des mesures nationales d’application.
C’est donc, le droit interne qui doit s’appliquer après transposition.
Cependant, afin de garantir les droits des justiciables lorsqu’un Etat n’a pas transposé la directive, celle-ci peut-être directement invoquée.
Certaines juridictions nationales, tel le conseil d’Etat dans l’arrêt Cohn-Bendit (22 décembre 1978), ont cependant été réticentes quant à l’invocabilité des directives.
Paradoxalement, cela a conduit la cour de justice a considéré que si la directive n’était pas directement applicable a l’encontre d’un particulier, elle l’était à l’égard de l’Etat considéré, ainsi, elle l’a jugée qu’une directive pouvait être invoqué à l’encontre de l’Etat employeur alors qu’elle ne l’est pas pour un employeur privé.
Aujourd’hui, le juge national, s’appuyant sur les directives communautaires d’harmonisation accepte d’interpréter le droit national sans réticence.

Etudiant dans le cadre du centre audiovisuel d'études juridiques. Vous pouvez comme lui nous transmettre par mail des documents rédigés par vos soins et nous les mettrons en ligne s'ils correspondent à nos critères :) |
|---|