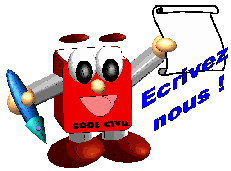Points difficiles
Synthèse
La proposition de directive établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
Position commune du 22 octobre 1999, JOCE C 343 30.11.99
Document rédigé par Jean-François ROUHAUD, juriste au sein de la SCP Druais-Michel-Lahalle (Rennes), dans le cadre d'un Séminaire de contentieux en droit national de l'environnement
le 14 mars 2000
La directive-cadre sur l'eau est la pierre angulaire d'une réforme de la politique communautaire de l'eau. Elle n'est cependant pas l'unique instrument de cette réforme. Notons simplement qu'elle s'accompagne :
- d'un programme ambitieux pour la protection et la gestion intégrée des eaux souterraines, du 10 juillet 1996 (programme non-contraignant, prévoyant notamment des plans d'action nationaux, dont les recommandations sont en partie reprises dans la directive-cadre).
- d'une refonte de la directive de 1980 sur les eaux potables (avec l'adoption de la directive du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine).
- d'une abrogation imminente de la directive de 1975 sur les eaux de baignade (avec la proposition de directive relative à la qualité des eaux de baignade, actuellement devant le Conseil pour une position commune).
Le contexte
1) L'existence d'un arsenal législatif
La politique de lutte contre la pollution des eaux est le volet le plus ancien et le plus complet de la politique communautaire de l'environnement. Lancée en 1973, elle a abouti en 20 ans à l'adoption de plus de 30 directives visant à la sauvegarde et à l'amélioration de la qualité du milieu aquatique. Par exemple :
- Directive de 1975 sur la qualité des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire (37)
- Directive de 1975 sur la qualité des eaux de baignade (. directive en voie d'abrogation)
- Directive du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique (313)
- Directive de 1977 instituant une procédure commune d'échange d'informations relatives à la qualité des eaux douces superficielles (37)
- Directive de 1978 sur la qualité des eaux piscicoles (313)
- Directive de 1979 relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire (37)
- Directive de 1979 sur la qualité des eaux conchylicoles (313)
- Directive de 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (313)
- Directive de 1980 sur la qualité de l'eau potable (. directive abrogée)
- Conférence ministérielle de Francfort en 1988 (juste après l'AUE) : les ministres européens de l'environnement tracent les grandes lignes d'une politique communautaire de l'eau pour les années 1990 (visée au considérant n°1)
- Directive de 1991 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines
- Directive de 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates
- 1994 et 1995 : projets de modification des directives sur les eaux de baignade et sur l'eau potable et proposition de directive sur la qualité écologique des eaux de surface
2) Une situation toujours préoccupante
La constitution de cet arsenal législatif et les investissements réalisés n'ont cependant pas permis d'induire une amélioration significative des ressources en eau de la Communauté (voir considérant n°3):
- les cas de dégradation des eaux sont nombreux (pollution des nappes phréatiques, augmentation des zones eutrophiées, acidification des eaux intérieures…),
- un phénomène de rareté de la ressource a fait son apparition.
3) Les principales insuffisances de l'actuelle gestion de l'eau
- Au plan national :
- les systèmes de gestion de l'eau diffèrent selon les structures administratives et le niveau de responsabilité à l'égard de l'eau.
- les approches du contrôle de la pollution, de l'agriculture, des politiques de développement et de la gestion des ressources hydriques peuvent être largement divergentes.
=> La coopération entre les Etats membres s'avère particulièrement difficile (alors que certains d'entre eux éprouvent une grande dépendance à l'égard des ressources partagées).
Au plan communautaire : les différentes mesures de l'UE ont surtout visé à
- protéger les ressources hydriques de certaines menaces spécifiques (substances dangereuses, nitrates…).
- vérifier que certains produits chimiques et bactéries restent en-dessous des normes correspondant à une utilisation donnée (alimentation, bain…).
=> Il n'y a cependant aucun accord global entre les Etats membres sur des problèmes plus larges de gestion de l'eau (approche fragmentée et focalisée sur les problèmes de qualité).
La genèse de la proposition
Conseil d'Edimbourg de 1992 : les chefs d'Etats et de gouvernement se prononcent en faveur d'une révision des directives sur l'eau. Objectif : introduire le principe de subsidiarité dans la législation, simplifier les textes, les consolider et les mettre à jour en fonction de l'évolution des connaissances et du progrès technique.
Juin 1995 : le Parlement européen et le Conseil demandent à la Commission de procéder à une révision globale de la politique communautaire de l'eau afin d'en améliorer l'efficacité, mais aussi la cohérence et la transparence.
Communication de la Commission au Parlement et au Conseil, le 21 février 1996 : la Commission annonce une refonte générale de la réglementation sur les ressources en eau en soulignant la nécessité d'adopter une approche intégrée, c'est-à-dire portant à la fois sur les aspects qualitatifs et quantitatifs du problème, tout en associant gestion des eaux de surface et gestion des eaux sous-terraines.
Il faut bien évidemment lire cette chronologie à la lumière des différents Traîtés fondateurs de l'UE, du Vème programme et du Vème programme modifié.
La procédure
Procédure de co-décision (article 251 anciennement article 189 B).
26 février 1997 : la Commission présente une proposition de directive-cadre (qui a fait l'objet de deux propositions modifiées avant la première lecture au Parlement)
11 février 1999 : le Parlement approuve la proposition moyennant 133 amendements
17 juin 1999 : la Commission présente une nouvelle proposition modifiée en acceptant 88 amendements
22 octobre 1999 : le Conseil adopte une position commune
Elle a récemment fait l'objet d'une deuxième lecture au Parlement.
Le contenu de la proposition
· Des objectifs qualitatifs et quantitatifs pour les eaux de surface et les eaux souterraines (considérant n° 30)
Sont visées les eaux intérieures de surface, les eaux de transition, les eaux côtières et les eaux souterraines (article 1er).
Une politique durable dans le domaine de l'eau doit répondre à 3 exigences (article 1er) :
- assurer l'approvisionnement en eau potable
- protéger l'environnement
- réduire les conséquences des inondations et des périodes de sécheresse
La Commission assigne à la future directive-cadre de prévenir la détérioration de l'état écologique et l'aggravation de la pollution et à restaurer toutes les masses d'eau de surface et d'eaux souterraines en vue de parvenir à un bon état des eaux, " au plus tard seize ans après la date d'entrée en vigueur " du texte (article 4-1). Dans les versions précédentes, l'objectif était " d'atteindre un bon état de toutes les eaux d'ici à 2010 ".
· L'approche " combinée " pour les sources ponctuelles et diffuses
La proposition de directive préconise une approche mixte : elle combine le recours à la fixation d'objectifs et de normes de qualité environnementale (article 4) à la réduction de la pollution à la source (article 10).
Elle fixe des normes de qualité environnementale au niveau communautaire pour un certain nombre de polluants, repris en annexe. Concernant les eaux utilisées pour le captage des eaux potables, d'autres normes de qualité environnementale sont fixées par les Etats membres.
Elle n'arrête pas de valeurs limites d'émission pour les polluants mais coordonne l'application de celles requises par d'autres textes, dont notamment la directive " IPPC ".
· Le " district hydrographique " comme structure de base de la gestion des eaux (article 3)
La proposition s'est alignée sur le modèle français en retenant le bassin hydrographique (appelé " district hydrographique ") comme unité administrative de base pour la gestion de l'eau (article 3-1).
Les Etats membres conservent une large marge d'appréciation quant aux choix des autorités responsables de la gestion des districts hydrographiques. Ils désignent l'autorité compétente trois ans après la date d'entrée en vigueur de la directive (dans les versions précédentes, cette date était le 31 décembre 1999).
· Des plans de gestion pour chaque district hydrographique (article 13)
Sur la base de la délimitation des districts hydrographiques, les Etats membres doivent élaborer des plans de gestion. Ceux-ci peuvent être complétés par des programmes ou des plans de gestion plus détaillés par sous-bassin, secteur, problème ou type d'eau.
Les plans de gestion devront inclure (annexe VII) :
- l'analyse de toutes les caractéristiques des districts hydrographiques (requises par l'article 5)
- un résumé des pressions et des incidences importantes de l'activité humaine (visée à l'article 5)
- l'identification et la représentation des zones protégées (visées à l'article 6)
- une carte des réseaux de surveillance (établis aux fins de l'article 8)
- une liste des objectifs environnementaux (fixés au titre de l'article 4)
- un résumé de l'analyse économique de l'utilisation de l'eau (requis par l'article 5)
- un résumé des programmes de mesures adoptés (au titre de l'article 11)
- un registre des autres programmes et plans de gestion plus détaillés
- un résumé des mesures prises pour l'information et la consultation du public
- une liste des autorités compétentes
- les points de contact et les procédures permettant d'obtenir des documents de référence et des informations (visées à l'article 14)
Les plans de gestion sont publiés au plus tard 10 ans avant après l'entrée en vigueur de la directive. Lors de leur mise à jour, c'est-à-dire, pour la première, seize ans après la date d'entrée en vigueur de la directive, puis, pour les autres, tous les six ans, le plan de gestion devra inclure des éléments supplémentaires dont notamment une évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs environnementaux (avec en particulier les résultats de la surveillance).
L'ensemble de ce dispositif comporte, pour chaque district hydographique, un programme de mesures (article 11) visant à permettre la réalisation des objectifs environnementaux (article 4). La proposition prévoit que ces programmes devront être établis au plus tard 10 ans après l'entrée en vigueur de la directive et qu'ils devront être opérationnels au plus tard 13 ans après cette entrée en vigueur.
Il est prévu des dispositions spécifiques en cas de pollution accidentelle.
· Tarification de l'usage de l'eau : définir un prix qui intègre l'ensemble des coûts (article 9)
L'utilisation judicieuse de l'eau et l'amélioration ou le maintien de sa qualité et de l'environnement ont un prix. La proposition de directive fait obligation aux Etats membres de prendre des mesures pour que le prix de l'eau reflète :
- le coût total de tous les services liés à l'usage de l'eau (exploitation, entretien, maintenance des équipements, investissements, extensions futures),
- ainsi que les coûts liés à l'environnement et à l'appauvrissement des ressources.
Cette récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau s'effectue sur la base d'une analyse économique conforme à l'annexe III et au principe pollueur-payeur.
Il est prévu des dérogations pour tenir compte :
- des effets sociaux, environnementaux et économiques de la récupération
- des conditions géographiques et climatiques de la région concernée
· Subsidiarité : agir au niveau local dans un cadre général
La proposition a pour objet d'établir les conditions propres à encourager une protection efficace de l'eau au niveau local : les Etats membres et les autorités compétentes locales sont confirmés comme des acteurs de premier plan, qui mettent en place la plupart des mécanismes et des mesures.
La proposition de directive prévoit néanmoins une coordination globale au niveau de l'Union européenne :
- dans le cadre de l'approche " combinée ",
- en instituant un mécanisme par lequel les autorités nationales pourront informer les autorités communautaires des problèmes devant être traités à un échelon supérieur ou transsectoriel (article 12).
· Information et participation du public : élargir le débat à toutes les personnes concernées
La proposition prévoit des modalités de publication et de participation du public (" y compris des utilisateurs ") lors de l'élaboration et de la mise à jour des plans de gestion (article 14).
La proposition présente une procédure de notification et d'échange d'informations être les Etats membres et la Commission ainsi que l'Agence européenne de l'environnement. Sont à communiquer :
- les plans de gestion et leurs mises à jour
- les analyses (article 5) et les programmes de surveillance (article 8)
- un rapport intermédiaire décrivant l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme des mesures prévues (dans un délai de 3 ans).
Conclusion
- La prise en compte de la dimension transfrontalière fait l'objet d'une attention particulière. Cela se traduit notamment par la possibilité, en présence d'un district hydrographique international sur le territoire de la Communauté, de produire un seul plan de gestion.
- L'impact du projet sur la législation existante :
--> 7 ans après la date d'entrée en vigueur de la directive sont abrogées 3 directives (voir page 1 : " 37 ")
--> 13 ans après la date d'entrée en vigueur de la directive sont abrogées 4 directives (voir page 1 : " 313 ")
- La Commision a souligné que de nombreux aspects du programme d'action de juillet 1996 sur les eaux souterraines ne pourraient être assurés par la directive-cadre, " car ces aspects relèvent d'autres politiques et de mesures à caractère moins formel ".
|
Après plusieurs années d'élaboration, la directive cadre sur l'eau a finalement été adoptée en septembre 2000. Elle a déçu nombre de commentateurs qui s'attendaient, au vu du projet de directive, à une réforme ambitieuse du droit communautaire de l'eau. Pour prendre connaissance du texte adopté, voir le site du Ministère de l'environnement (www.environnement.gouv.fr dans le dossier thématique "eau").
|
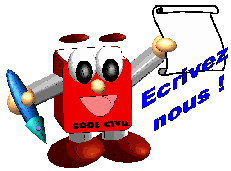
Dernière mise à jour : avril 2001