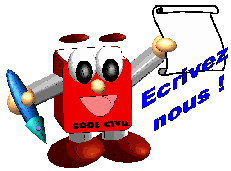Travaux dirigés
Travaux dirigés
Ils comptent pour 50 % de la note de la matière étudiée (matière à TD donc). Dans ces TD (généralement moins de 40 personnes par groupes de td), on approfondit une notion à partir d'une fiche de TD (environ 20 pages dont beaucoup d'arrêts) donnée une semaine auparavant et préparée par nous (les étudiants) : explication des arrêts par une fiche d'arrêt + un exercice plus long (plan détaillé de commentaire, commentaire, dissertation, ou cas pratique). C'est pendant ce laps de temps (maximum 2 heures) que l'on a l'occasion de demander des explications sur un point précis du cours. C'est aussi l'occasion de parler (lors d'interrogation orale du prof, ou de participation volontaire).
C'est donc un point fondamental des études de droit. Pour autant, ce n'est pas parce que l'on est "timide" que l'on ne parlera pas en TD. Il suffit d'avoir préparé sa fiche, et de lever la main pour être interrogé, même si on en a pas envie, à chaque fois que le prof demande quelqu'un pour l'explication d'un arrêt, d'un texte, d'une notion de cours.
La notation des TD se compose généralement à 50 % d'une note d'oral (!), et à 50 % d'une note d'écrit. La note d'oral apprécie les participations, volontaires ou non, à l'occasion d'une étude de la fiche ou d'une interrogation orale sur le cours au début du TD. La note d'écrit est la moyenne des notes obtenues lors de devoirs rendus ou relevés. A noter que cette note de TD est à la discrétion des chargés de TD généralement, et qu'il n'est pas rare que l'oral pèse beaucoup plus que l'écrit. Une bonne participation en TD assure donc quasiment une réussite dans l'année, au moins dans les matières étudiées en TD. A ne pas négliger ou sous estimer donc.
Pour en savoir plus sur les TD, cliquez ici
 Le droit est, contrairement à ce que l'on peut penser de prime abord, une discipline très vaste. On s'en rend compte en énumérant les différentes professions auxquelles des études de droit peuvent mener, on s'en aperçoit également en observant l'emploi du temps d'un étudiant en droit...
Le droit est, contrairement à ce que l'on peut penser de prime abord, une discipline très vaste. On s'en rend compte en énumérant les différentes professions auxquelles des études de droit peuvent mener, on s'en aperçoit également en observant l'emploi du temps d'un étudiant en droit... Droit constitutionnel
Droit constitutionnel