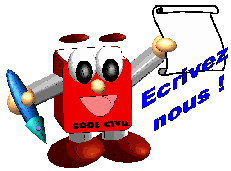Université de LIMOGES
Faculté de Droit et des Sciences Economiques
Avril 1999
Les exceptions jurisprudentielles à la libre circulation des marchandises au titre de la protection de l'environnement
Sous la direction de Monsieur Jean-Louis CLERGERIE et du Professeur Michel PRIEUR
Mémoire de droit communautaire pour la Maîtrise en droit public et la deuxième année de Magistère en droit de l'environnement et de l'urbanisme.
- Jean-François ROUHAUD -
Introduction
Encouragé par plus de quarante années d'efforts en matière d'intégration économique, le commerce intra-communautaire connaît depuis ses origines un essor considérable. Les chiffres en témoignent : de 1958 à 1988, il s'est multiplié par 37 en valeur nominale et par 8 en valeur réelle. Du point de vue des échanges mondiaux, le poids de la Communauté est passé de 11,8 % en 1957 à 22,3 % en 1987.[1]
Ce dynamisme qui a fait de la Communauté la première puissance mondiale en la matière, peut s'expliquer par " la proximité tant géographique qu'économique de ses membres "[2]. En effet, la facilité " des liens diplomatiques et commerciaux entre partenaires ", " la proximité des niveaux de développement et des structures de demande et d'offre des économies européennes ", ainsi que " le processus d'élimination des droits de douane "[3] sont autant de facteurs qui contribuent à cette réussite.
En même temps, l'acuité des préoccupations environnementales a obligé les autorités communautaires à développer une véritable politique de l'environnement.[4]
Ainsi, devant la nécessité de concilier l'essor de son marché intra-communautaire et les contraintes environnementales plus fortes et plus nombreuses, le juge des Communautés européennes a été amené à articuler les objectifs de protection de l'environnement dans l'organisation du marché intérieur.
La nécessité de concilier libre-échange et environnement peut trouver une justification dans deux observations, dont l'exposé va surtout permettre de comprendre le contexte et l'objet de cette étude.
Il semble tout d'abord évident que l'essor du commerce intra-communautaire, qui passe nécessairement par une intensification des échanges, n'est pas sans conséquence sur l'environnement.[5]
Un rapport de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) souligne très clairement " les effets environnementaux des échanges "[6]. Il distingue en effet trois catégories d'effets, tant positifs que négatifs, qu'il convient ici d'évoquer pour bien prendre la mesure et saisir les réalités de l'étude qui va suivre.
Une première catégorie d'effets se rapporte aux " échanges internationaux de certains produits et services ayant des effets écologiques "[7]. Il s'avère en effet que le commerce peut favoriser une meilleure " diffusion des biens qui concourent à la protection ou qui offrent des solutions de rechange aux produits nuisibles pour l'environnement "[8] (effets positifs). Toutefois, les mouvements internationaux de biens comme les déchets dangereux, les organismes génétiquement modifiés, les substances chimiques ou les espèces menacées, sont également susceptibles de porter atteinte aux écosystèmes (effets négatifs).
L'étude de l'OCDE met en exergue une deuxième catégorie d'effets environnementaux des échanges, liée cette fois " au rôle que jouent les échanges internationaux dans l'accroissement du niveau ou de l'échelle de l'activité économique globale et de l'extension des marchés "[9]. En augmentant les revenus et les richesses nationales d'une manière générale, les échanges peuvent en effet favoriser les actions en faveur de l'environnement et augmenter la part des ressources financières qui leur est destinée (effets positifs). Mais " le commerce peut [également] exacerber les problèmes d'environnement lorsque l'expansion des activités mondiales de production et de consommation, se produit en l'absence de mesures visant à maîtriser les éventuels impacts négatifs sur l'environnement provoqués par la défaillance du marché (...) "[10] (effets négatifs).
Enfin une troisième et dernière catégorie d'effets peut être relevée. Elle est relative aux " schémas de production et d'utilisation des ressources résultant de facteurs d'ordre commercial ". Ainsi, dans la mesure où les échanges permettent à l'activité économique de se répartir de manière cohérente par rapport aux capacités environnementales de chaque pays, l'utilisation des ressources se révèle efficiente. Le développement véhiculé par le commerce est durable à l'échelle planétaire (effets positifs). En revanche, si les défaillances du marché et des interventions favorisent l'implantation d'activités de production et de consommation dans des zones géographiques qui n'en ont pas les capacités d'accueil, les ressources sont rapidement victimes d'un surcroît d'exploitation. L'équilibre écologique d'une région du monde est alors menacé (effets négatifs).
Au vu de ce rapport et notamment de ces trois catégories d'effets, il ne semble faire aucun doute que la libération des échanges de marchandises, présentée unanimement comme " le principal moteur de la Communauté "[11], soulève des doutes, des questions voire des difficultés en matière d'environnement.
Ces observations ne doivent cependant pas occulter une seconde justification possible de la nécessité de concilier essor du marché intra-communautaire et contraintes environnementales : la mise en concurrence, au sein de l'ordre juridique communautaire, du principe de libre circulation des marchandises et de l'objectif de protection de l'environnement[12].
Dans l'histoire de la construction européenne, la prise en considération du principe de libre circulation des marchandises et l'attention accordée à la protection de l'environnement ont connu une importance relativement différente.
Comme il en a été fait allusion dans les réflexions précédentes, le principe de libre circulation des marchandises[13] constitue la pierre angulaire du marché intérieur sur laquelle s'est construite la Communauté européenne. Il est d'ailleurs souvent appréhendé comme l'un des " quatre piliers " du marché commun au côté de la libre circulation des personnes, de la libre prestation des services et de la libre circulation des capitaux. Inscrit dès l'origine dans le Traité de Rome, ce principe fait aujourd'hui l'objet de ses articles 9 à 37 (nouveaux articles 23 à 31 de la version consolidée du Traité instituant la Communauté européenne, modifiée par le Traité d'Amsterdam signé en 1997)[14].
L'évolution de la protection de l'environnement [15] au sein des textes communautaires a pour sa part été beaucoup plus progressive. Le Traité de Rome étant muet sur la question, les premières directives relatives aux pollutions ou à la protection de la nature ont été adoptées sur la base de l'article 100 (nouvel article 94), prévoyant la réalisation du marché commun, ou sur la base de l'article 235 (nouvel article 308), permettant à la Communauté d'agir sur le fondement de ses compétences subsidiaires. C'est seulement en 1986 avec l'Acte unique européen que la protection de l'environnement est officiellement consacrée. L'insertion des articles 130 R à T (nouveaux articles 174 à 176)[16] l'intègre effectivement au rang des actions de la Communauté et lui donne ainsi une base juridique dans le droit communautaire originaire. Ensuite, avec le Traité sur l'Union européenne signé à Maastricht en 1992, les objectifs de protection de l'environnement sont renforcés. Dans sa nouvelle version, l'article 2 (nouvel article 2) dispose que " la Communauté a pour mission [notamment] de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté, une croissance durable et non-inflationniste respectant l'environnement ". Par ailleurs, l'article 3 (nouvel article 3) place la protection de l'environnement et la libre circulation des marchandises au même rang parmi les actions de la Communauté.
Cette évolution du droit communautaire ne va pas sans poser des difficultés. Elle aboutit effectivement à conférer, au sein des politiques communautaires, la même place au principe de libre circulation des marchandises et à l'objectif de protection de l'environnement, alors que leur mise en œuvre, si elle n'est pas antagoniste, est parfois concurrente et conflictuelle. Il paraît donc " légitime de s'interroger sur la manière dont l'Union européenne appréhende ces deux préoccupations fondamentales mais parfois manifestement inconciliables "[17].
Avant toute explication concernant l'Union européenne, il est intéressant d'observer brièvement la manière dont commerce et environnement sont articulés au niveau américain.
Cela conduit effectivement à comprendre le dispositif mis en place par l'Accord de libre-échange américain (ALENA), qui institue un espace économique comparable à celui de l'Europe des quinze. Cet accord signé en 1992 par le Mexique, les Etats-Unis et le Canada comporte d'assez nombreuses et importantes dispositions environnementales. Il prévoit notamment que cinq conventions internationales en matière d'environnement[18] contenant des dispositions commerciales prévalent, en cas de conflit de normes, sur les termes de l'ALENA. Il permet aussi à chaque partie d'établir les normes de son choix dans l'objectif de protéger l'environnement, sous la double réserve qu'elle n'introduise pas de traitement discriminatoire aux marchandises des autres Etats parties à l'accord et qu'elle n'entrave pas de manière superflue le commerce entre ces mêmes Etats. La conclusion d'un accord additionnel sur l'environnement en août 1993 permet enfin aux pays signataires de contraindre une des parties à appliquer sa législation nationale. Cette disposition se justifie par les comportements des entreprises nord-américaines qui ont eu tendance à se délocaliser au Mexique pour éviter les mesures écologiques souvent drastiques édictées par leurs autorités nationales.
On en déduit que la stratégie commerciale américaine a fortement intégré la dimension environnementale. Commerce et environnement sont en effet largement interdépendants : le dispositif régional de libre-échange doit notamment respecter certaines contraintes du droit international de l'environnement, tandis que les initiatives nationales de protection de l'environnement sont soumises au respect de la libre circulation des marchandises. Comme le soulignent certains auteurs, on peut penser que cela illustre " le reflet d'une conscience sociale plus développée que dans les autres régions du monde "[19]. Toutefois, si la politique commerciale américaine reste un exemple en matière d'intégration environnementale, il faut noter que la stratégie de la Communauté européenne en ce domaine s'affine peu à peu.
Les Traités institutifs restant muets sur la recherche d'un tel équilibre, c'est le juge des communautés européennes qui a été amené à oeuvrer en ce domaine. En effet, la conciliation des exigences commerciales et environnementales est avant tout le fruit d'une construction prétorienne de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), engagée il y a maintenant une trentaine d'années en matière de libre circulation des marchandises. Cette construction prétorienne amènera ensuite la juridiction luxembourgeoise à consacrer des exceptions à la libre circulation des marchandises au titre de la protection de l'environnement.
Ce mouvement jurisprudentiel dont il est important de retracer les principales lignes repose tout d'abord sur le principe de prohibition des entraves au libre-échange.
Deux dispositions du Traité de Rome sont en la matière essentielles : d'une part l'article 30 (nouvel article 28), qui prévoit l'interdiction entre Etats membres des restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que de toutes mesures d'effet équivalent, et d'autre part l'article 34 §1 (nouvel article 29), qui énonce la même interdiction mais cette fois-ci à l'exportation. Ces dispositions ont connu un développement jurisprudentiel considérable à partir de deux décisions de la CJCE qui aujourd'hui font date.[20]
Le première vient circonscrire la notion de marchandise, indispensable pour la lecture des articles 30 et 34 qui s'appliquent au commerce des marchandises. Dans l'affaire " Commission contre Italie ", jugée le 10 décembre 1968, la Cour les définit comme les " produits appréciables en argent ou susceptibles, comme tels, de former l'objet de transactions commerciales "[21].
La seconde décision vient quant à elle préciser la notion de mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives, essentielle pour bien cerner les différents obstacles de nature à entraver les échanges intra-communautaires. Dans l'arrêt " Dassonville " du 11 juillet 1974, la CJCE énonce ainsi " que toute réglementation commerciale des Etats membres susceptible d'entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra-communautaire est à considérer comme mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives "[22].
Le champ d'application des articles 30 et 34 est ainsi particulièrement étendu. La notion de marchandise peut effectivement désigner tout type de transaction, y compris celles effectuées par un particulier. Elle englobe les produits industriels, les produits agricoles ou de la pêche, mais encore les " produits " que l'on a du mal à définir comme tels (les oeuvres d'art par exemple). Chaque élément de la définition extensive formulée par l'arrêt " Dassonville " a par ailleurs été largement interprété. Imputable obligatoirement à un Etat membre, les mesures restrictives des articles 30 et 34 peuvent concerner " ...les dispositions législatives, réglementaires et administratives, les pratiques administratives, ainsi que tous actes émanant d'une autorité publique, y compris les incitations (...) qui font obstacles à des importations qui pourraient avoir lieu en leur absence, y compris les mesures qui rendent plus difficiles ou onéreuses que l'écoulement de la production nationale "[23]. Les effets restrictifs des mesures d'effet équivalent peuvent encore n'être que potentiels ou de faible importance.
Cette interprétation maximaliste de la CJCE peut s'expliquer par la volonté de donner sa pleine portée à l'objectif fondamental inscrit dès 1957 dans le Traité de Rome qu'est la libre circulation des marchandises. Elle implique en tous les cas que soient précisément mesurées les incidences des mesures nationales sur les échanges intra-communautaires de marchandises.
Toutefois, le juge communautaire est aussi amené à vérifier la légitimité des entraves que peuvent générer les mesures nationales, car l'interdiction de principe des mesures d'effet équivalent comporte des exceptions.
L'œuvre créatrice du juge des Communautés européennes en matière de libre circulation des marchandises concerne aussi les dérogations à l'interdiction des entraves aux échanges intra-communautaires. On peut en relever principalement deux catégories.[24]
La première série d'exceptions est prévue par l'article 36 du Traité de Rome (nouvel article 30) et concerne aussi bien l'interdiction de l'article 30 que celle de l'article 34. Elle énonce une liste d'intérêts susceptibles de justifier certaines entraves à la libre circulation. On trouve ainsi " des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ".
La seconde série d'exceptions souvent qualifiées d'" exigences impératives "[25] a été forgée par la jurisprudence sur la base de l'article 30. Dans son arrêt de principe du 20 février 1979 " Cassis de Dijon ", la Cour estime effectivement que " les obstacles à la libre circulation intra-communautaire résultant des disparités des législations nationales relatives à la commercialisation des produits (...) doivent être acceptées dans la mesure où ces prescriptions peuvent être reconnues comme étant nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives, tenant notamment à l'efficacité des contrôles fiscaux, à la protection de la santé publique, à la loyauté des transactions commerciales et à la défense des consommateurs "[26].
Ces deux principales catégories d'exceptions ont toutes deux pour objet de rendre licite, en l'absence de réglementation commune[27], une mesure nationale relevant des articles 30 et 34. Elles ont aussi en commun d'être soumises au principe générique de proportionnalité, dont le respect confère à la mesure nationale entravante la possibilité d'être justifiée.
Comme le souligne Jean-Claude MASCLET, " la démarche de la Cour de justice dans l'examen des mesures nationales abritées derrière ces exigences est en tout point semblable à celle adoptée face aux mesures de l'article 36 : vérification du rapport direct existant entre la mesure ou pratique en cause et l'intérêt protégé, vérification de leur adéquation à cet objectif (...), enfin proportionnalité, ce qui permettra de condamner ces mesures ou pratiques lorsque la protection des intérêts visés peut être assurée par des dispositions moins restrictives du commerce intra-communautaire "[28].
Toutefois, leur nature et leur domaine d'application est bien distinct. Comme le précise notamment Nicolas DE SADELEER, " deux différences essentielles séparent ces deux régimes dérogatoires : d'une part, les 'raisons' de l'article 36 sont exhaustives alors que les 'justifications' [de l'article 30] ne le sont pas et, d'autre part, seules les mesures indistinctement applicables peuvent bénéficier d'une exemption au titre des exigences impératives[29] alors que ce n'est pas le cas au titre de l'article 36 "[30];.
Ces développements jurisprudentiels sont fondamentaux car c'est sur la base des exceptions à l'interdiction des entraves au libre-échange qu'ont principalement été intégrées les exigences environnementales.
Le juge des communautés européennes a effectivement cherché à concilier libre-échange et environnement en reconnaissant des exceptions à la libre circulation des marchandises au titre de la protection de l'environnement.
L'utilisation de l'article 36 à cette fin n'a pas été et n'est toujours pas très pertinente dans la jurisprudence de la CJCE. Il faut souligner en effet que la protection de l'environnement n'est pas prévue parmi les intérêts permettant de déroger à l'interdiction.
Il est vrai que les justifications liées à " la sécurité publique ", à " l'ordre public ", à " la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ", ou à " la préservation des végétaux " peuvent se rapprocher et s'appliquer plus ou moins directement en matière d'environnement. Cependant ces intérêts d'interprétation stricte sont trop limités ou peu adaptés à la cause environnementale[31]. Comme le dit à ce propos Fabrice PICOD : " consciente de la dimension de la protection de l'environnement et de son autonomie vis-à-vis des raisons prévues à l'article 36, la Cour lui a reconnu un statut d'exigence impérative permettant aux Etats membres de justifier, sur le fondement même de l'article 30 du traité, certaines entraves qui tombaient a priori sous le coup de l'interdiction posée par cet article "[32].
L'objet de l'étude qui suit va justement porter sur cette reconnaissance très prometteuse pour la protection de l'environnement. Nous allons en effet chercher à comprendre la manière dont la protection de l'environnement à part entière, et non pas des intérêts s'y rattachant, a pu justifier des dérogations au principe de libre circulation des marchandises. Autrement dit, il va être question ici d'analyser la démarche du juge communautaire consistant à appliquer la jurisprudence relative aux " exigences impératives ", aux cas de conflit entre les mesures nationales de police de l'environnement et l'article 30 du Traité de Rome. Il ne sera par conséquent pas traité ici des exceptions de l'article 36[33].
Si l'analyse juridique entreprise est relativement " ciblée " et constitue une question très précise du droit communautaire, elle n'est cependant pas dénuée d'intérêt. D'un point de vue théorique tout d'abord, elle est le moyen de se familiariser avec la démarche, les concepts et les orientations du juge communautaire, acteur de premier rang dans la mise en œuvre des politiques publiques de la Communauté européenne. Elle nous conduit aussi à aborder la libre circulation des marchandises qui, de très loin, " a généré le contentieux le plus important, contribuant largement à façonner le droit communautaire de l'environnement "[34]. D'un point de vue plus pratique ensuite, cette étude nous amène à comprendre la manière dont l'environnement semble devenir, si ce n'est déjà le cas, " une nouvelle donne économique "[35]. Le libre-échange à tout crin doit effectivement, comme nous l'avons souligné dans les lignes qui précèdent, faire face aux exigences environnementales. On peut enfin ajouter que l'intégration jurisprudentielle de l'environnement en matière de libre-échange est vouée à connaître un développement important. Il sera effectivement très intéressant d'observer dans quelques années la diversité des situations que peut recouvrir cette " construction " juridique[36], qui aujourd'hui ne concerne quasiment que le droit communautaire des déchets.
Afin de circonscrire le sujet tout en évitant d'exposer de façon trop descriptive la jurisprudence, le parti choisi pour bien comprendre la démarche du juge communautaire a été celui d'analyser la manière dont la protection de l'environnement est devenue une justification à l'interdiction d'entraves, en comparaison des principaux critères retenus dans l'arrêt " Cassis de Dijon "[37]. Cela revient en fin de compte à observer les aspects originaux et les éléments classiques de l'application de cette jurisprudence.
C'est ainsi que l'analyse des quelques arrêts importants en la matière, concernant essentiellement comme nous l'avons dit le domaine des déchets, met en exergue une transposition des critères jurisprudentiels de l'arrêt " Cassis de Dijon " (partie 1). La démarche traditionnelle adoptée par le juge en 1979 est donc respectée. Il nous faudra néanmoins souligner les limites à cette transposition (partie 2). Les spécificités tenant à l'environnement ou au droit de l'environnement viennent en effet contredire dans une certaine mesure, l'application pure et simple de la jurisprudence relatives aux " exigences impératives ".
1ère partie : la transposition des critères jurisprudentiels de l'arrêt " Cassis de Dijon " en matière d'environnement
Section 1 : la reconnaissance de la protection de l'environnement au titre des " exigences impératives
§ 1- La consécration d'un " objectif environnemental d'intérêt général "
§ 2- D'un " objectif environnemental d'intérêt général " à une " exigence impérative " de protection de l'environnement
Section 2 : l'application du principe de proportionnalité aux mesures nationales de protection de l'environnement
§ 1- Le contrôle de proportionnalité dans l'arrêt " Bouteilles danoises " (1988)
§ 2- La recherche d'un équilibre entre environnement et libre-échange
Section 1 : la reconnaissance de la protection de l'environnement au titre des " exigences impératives
§ 2- D'un " objectif environnemental d'intérêt général " à une " exigence impérative " de protection de l'environnement
Section 2 : l'application du principe de proportionnalité aux mesures nationales de protection de l'environnement
§ 2- La recherche d'un équilibre entre environnement et libre-échange
2ème partie : les difficultés d'application de la jurisprudence " Cassis de Dijon " en matière d'environnement
Section 1 : les difficultés tenant à la mise en œuvre de principes classiques du droit de l'environnement
§ 2- Un retour à l'orthodoxie de 1979 : l'arrêt " Safety Hi-Tech Srl " (1998)
Section 2 : les difficultés résultant de la spécificité du champ environnemental
§ 2- Une difficulté générale : un objectif de protection de l'environnement imprécis
Annexes
Annexe 1 : CJCE, 7 février 1985, " ADBHU ",
affaire 240/83, recueil p. 531 (extrait)Annexe 2 : CJCE, 20 septembre 1988, " Commission contre Danemark ", affaire 302/86, recueil p. 4607 (extrait)
Annexe 3 : CJCE, 9 juillet 1992, " Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique ", affaire C-2/90, recueil p. I-4431 (extraits)
Annexe 4 : CJCE, 14 juillet 1998, " Safety Hi-Tech Srl ", affaire C-284/95, recueil p. I-4301 (extraits)

Vous pouvez comme lui nous transmettre par mail des documents rédigés par vos soins et nous les mettrons en ligne dès lors qu'ils correspondent à nos critères :). Si vous souhaitez prendre contact avec Jean François, n'hésitez pas à nous écrire. |
|---|